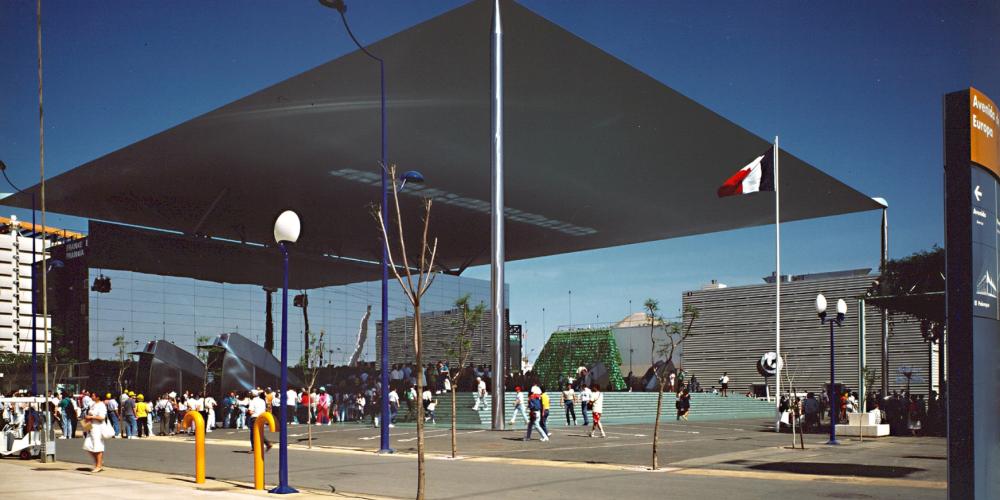Appliquer les principes de l'architecture moderne à un chef d'œuvre de l'Antiquité

Quelle a été votre première réaction lorsqu'on vous a demandé de travailler sur le Pont du Gard ?
J-P.V. : C'était un problème très complexe et un projet inhabituel et surprenant pour moi. Je n'avais jamais eu à faire face à des problèmes patrimoniaux de ce niveau auparavant. Au début, j'étais sceptique, mais lorsque j'ai rencontré les archéologues, j'ai réalisé que je pouvais aider à améliorer l'architecture du site. C'est le frisson à la vue du monument qui a terminé de me persuader. Les archéologues m'ont expliqué quelque chose que je n'avais pas saisi auparavant et que la plupart des visiteurs n'ont pas compris : le rôle de l'eau dans la conquête romaine, à la fois source de pouvoir et outil essentiel de modernisation des villes et la supériorité technologique que la maîtrise de cet élément prouvait au reste du monde antique. Ceci est brillamment illustré par l'aqueduc.
Et puis, il y a ce sentiment indescriptible quand vous venez ici et que vous voyez le monument, décrit par Stendhal dans ses Mémoires d'un touriste (1854) : « Par bonheur pour le plaisir du voyageur né pour les arts, de quelque côté que sa vue s’étende, elle ne rencontre aucune trace d’habitation, aucune apparence de culture : le thym, la lavande sauvage, le genévrier, seules productions de ce désert, exhalent leurs parfums solitaires sous un ciel d’une sérénité éblouissante. L’âme est laissée tout entière à elle-même, et l’attention est ramenée forcément à cet ouvrage du peuple-roi qu’on a sous les yeux. »
Quelle approche adoptez-vous lorsque vous travaillez sur un site aussi emblématique que le Pont du Gard ?
J-P.V. : Tout d'abord, vous devez rechercher et reconnaître le site. Un site historique est à la fois un atout patrimonial et un bâtiment, en ce sens qu'il s'agit d'un monument, d'un aqueduc, mais aussi d'un terrain. Et dans le cas du Pont du Gard, cette terre et le bâtiment sont intrinsèquement liés. Ici, c'est le site qui a influencé la construction de l'aqueduc, et c'est l'aqueduc qui célèbre le site et vous obtenez ainsi un cercle vertueux architectural entre le patrimoine historique du monument, le site et son paysage environnant. Vous devez comprendre cela en premier et traiter les deux fronts. Vous pouvez mettre en évidence le site en regardant le monument et vous pouvez célébrer le bâtiment en rendant le site adapté.
Quels ont été les grands principes du développement du site du Pont du Gard ?
J-P.V. : Au départ, les grands principes du développement du Pont du Gard étaient plutôt compliqués et controversés, mais dans le projet final, tout est devenu beaucoup plus simple. Tout d'abord, il y a le principe de la découverte ; lorsque le monument est considéré de manière isolée, il est impossible d'apprécier pleinement le défi que représente sa construction. Il était donc important d'ouvrir tout le site au public. Dans le cadre du projet final, 120 ha du site ont été mis à disposition : c'était le plus petit espace nécessaire pour réellement apporter la compréhension au public.
Les archéologues ont également apporté de nouvelles découvertes telles que des bassins de régulation, la construction de certains ponts, des chalumeaux et des ponceaux, ainsi que des explications sur la disposition de l'aqueduc actuel. Donc, l'idée de pouvoir explorer le site était essentielle. Le deuxième principe convenu était l'importance de communiquer la réalité de cette découverte. Pour ce faire, vous devez créer les outils appropriés : un centre d'interprétation.
Abordez-vous un projet architectural à forte dimension culturelle différemment des autres projets ?
J-P.V. : Tous les projets que je conçois sont culturellement significatifs, c'est-à-dire qu'en architecture la dimension culturelle est inséparable de la conception architecturale elle-même. Différents bâtiments ont des objectifs et des usages différents. Dans un cas, il pourrait s'agir d'un musée d'art moderne, comme celui que j'ai construit au Texas, à San Antonio, aux États-Unis ; ici, c'est un musée consacré à l'archéologie et à l’Antiquité. Le bâtiment est utilisé à des fins différentes à chaque fois, mais sa signification culturelle est toujours la même. En tant qu'architecte, je suis responsable de la création d'un bâtiment qui héberge ces activités et j'utilise toujours le même média pour établir une connexion entre le public età la structure : la lumière. Pour moi, la lumière est ce qui permet de relier l'observateur, ou le visiteur dans le cas d'un musée, à la structure. Donc, la conception du bâtiment est toujours très sophistiquée en termes de lumière et, d'un point de vue architectural, c'est vraiment là que réside la différence.